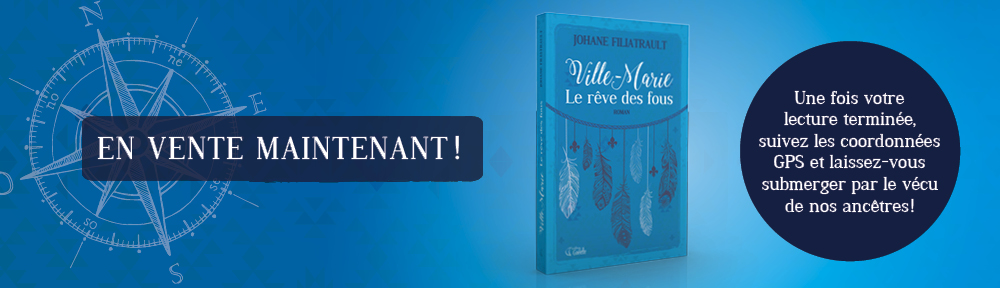Examen final de Christologie – Par Johane Filiatrault, le 19 avril 2009
1. Au début du cours, il vous a été demandé de répondre à la question suivante (posée par Jésus) : « Et vous, qui dites-vous que je suis? » Trois mois plus tard, après tout le cheminement du cours, en quoi la réponse que vous donniez alors à cette question s’est-elle confirmée ou modifiée?
Au début du cours, j’avais répondu à cette question : «Tu es Adonaï, mon Adôn », réponse qui résume toute mon expérience spirituelle avec le Christ. Depuis que j’ai l’âge de 16 ans, j’éprouve envers Lui une fascination totale, qui ne s’est jamais démentie. Et si j’avais vécu de son temps, j’aurais été tout à fait happée par sa personnalité; j’aurais absolument voulu le suivre partout pour pouvoir l’entendre enseigner, boire ses paroles, pour le regarder agir, m’étonner de sa différence radicale d’avec les autres humains que nous sommes. Jésus le Nazoréen est un être à part, profondément aimant, qui fait preuve d’une étonnante connaissance du coeur et de l’esprit humain, bien avant la psychologie moderne. Il est pour moi un aimant qui m’attire irrésistiblement parce qu’il me subjugue tout à fait et me ravit sans cesse. En Lui je trouve tout assouvissement de mes désirs les plus chers, tout élan qui me pousse à aimer. Il est Celui à travers qui je reçois tout ce qui me comble. Mon Maître et mon Seigneur. « Nul ne peut servir deux Adôn »(Mt 6,24), a dit Jésus. Il est un Maître doux et humble et son enseignement est nourriture et source de Vie. Le suivre est un chemin de joie et nous courons avec Lui de hauteur en hauteur. La vie avec Lui est une suite ininterrompue de surprises et d’aventures inouïes, un flot de grâces providentielles. C’est à ce Maître aimable et aimé que j’ai confié toute mon existence; et je cherche chaque jour à lui être davantage dévouée. « Adôn », c’est de cette manière également que le centurion appelle Jésus : « Ne te fatigue pas! Non, je ne vaux pas que tu entres sous mon toit… Mais dis une parole, que mon garçon soit rétabli. Oui, je suis un homme soumis à une autorité, et j’ai sous moi des soldats. Je dis à l’un : « Va! » et il va; à l’autre : « Viens !» et il vient; et à mon serviteur : « Fais cela! » et il le fait. » Et Chouraqui continue dans sa traduction : « Iéshoua entend et s’étonne de lui. Il se tourne vers la foule qui le suit et dit : « Je vous dis : je n’ai pas trouvé en Israël une telle adhérence. » Lc 7, 6 à 9 Le centurion reconnaît en Jésus le Seigneur qui a autorité sur la maladie et la mort, et il éprouve envers Lui la révérence et la confiance due à un tel Maître. Jésus, quant à Lui, s’émerveille de la foi de cet homme, et s’en réjouit. Un lien Maître-disciple est créé, un lien de reconnaissance mutuelle où chacun s’émerveille de ce qu’est l’autre, un lien de réciprocité : Celui qui donne a besoin d’être reçu, appelé et cru; celui qui ressent un manque a besoin d’une réponse et d’une action en sa faveur qui comblera ses attentes. C’est le type de lien qui m’unit au Christ.
Tout au long de ce cours, j’ai découvert d’autres regards sur le Christ, d’autres façons de le percevoir, et de le dire. Toutes étaient teintées des événements et de la culture de l’époque de l’observateur, marquées donc, également, de son expérience personnelle. Toutes contenaient une parcelle de la Vérité qu’est le Christ, toutes
Commentaire [r1]:
Excellente réponse : claire, profonde, très bien rédigée.
Note : 29,3 / 30
décrivaient un des multiples visages du Dieu Un. Que de fascination Il a, de toujours, exercé sur l’humanité, pour qu’on ait écrit, dit, chanté, joué, tant et tant, et tant de choses sur Lui! Cela a confirmé en moi son titre d’Adôn, puisqu’Il est le personnage de l’histoire qui ne laisse personne indifférent, qui oblige à prendre position, à se questionner sur Lui, à crier son désarroi ou à chanter sa foi, à adhérer ou à remettre en question, à interpréter l’histoire ou à revisiter sa propre vie – y cherchant un sens, un éclairage, une leçon à transmettre. Il fascine au point de donner, à leur tour, à ses émules le goût d’être, comme Lui, un chemin pour leurs frères et soeurs, un enseignant, un guide, chose que l’être humain cherche à faire avec plus ou moins d’adresse ou d’à propos – on a que trop de malheureux exemples de soi-disant « gourous » qui cherchent un public. Rien de cela en Jésus : Il ne garde rien pour Lui. Toute gloire est pour son Père, et son esprit de serviteur tout aimant le conduit à passer par la mort même pour nous montrer le chemin. Il est le guide par excellence, le modèle du troupeau. Mon Adôn.
J’écoutais récemment avec mes enfants une émission de « Secondaire en spectacle » où des étudiants jouaient un sketch de leur composition dans lequel ils présentaient Jésus comme une sorte de gourou égocentrique et mégalomane, avec son groupe d’apôtres, tout aussi ridicules. Est-ce là le fruit d’une Église non signifiante et d’une transmission incohérente, ou est-ce le reflet d’une génération en perte de repères, qui n’accorde plus beaucoup d’importance aux choses de Dieu? Repensant à ce que nous avons parcouru ensemble durant ces trois mois, je conclurais aujourd’hui qu’ils émettaient eux aussi, à leur façon, leur discours sur le Christ, et qu’ils faisaient donc, en quelque sorte, de la christologie! Après tout, ils auraient pu choisir mille et un autres sujets pour leur pièce de théâtre! S’ils ont choisi celui-là, c’est qu’ils accordent une importance aux choses de Dieu. Peut-être que ce qu’ils rejettent, au fond, c’est la manière des êtres humains de se faire maître et seigneur – quand ils regardent les modèles qu’ils ont sous les yeux, dans les institutions ecclésiales ou hors d’elles? Peut-être qu’au-delà de leur rejet, ils aspirent à un maître doux et humble, qu’on ne leur a pas encore suffisamment présenté? Je suis comme eux : je ne veux qu’aucun maître et seigneur règne sur moi par la force, la tromperie ou l’ambition. Je suis, comme eux, portée à tenir pour méprisables ceux qui cherchent à exercer un tel empire. Je le rejette aussi ce Christ-là, défiguré par notre piètre témoignage de chrétiens. Finalement, je continue de prier l’humble Père du Ciel de nous dévoiler le visage de son Christ, parce qu’en nous le dévoilant, nous l’aimerons, et qu’en l’aimant, nous connaîtrons la Joie, celle de nous soumettre entièrement à l’humble empire d’un tel Maître, Celui-là même qui s’est révélé Époux.
Commentaire [r2]:
Y compris beaucoup de preachers qui se réclament de Jésus lui-même.
Commentaire [r3]:
Très bonne remarque. Il importe d’apprendre à entendre ce qui est dit à travers les discours qui paraissent, à prime abord, « contre ».
2. Le cours que vous avez suivi vous indique une certaine manière de faire de la christologie. Décrivez cette démarche et expliquez-en l’importance pour aujourd’hui.
Tout au long de ce cours, nous avons suivi un cheminement kaïrologique, partant de notre propre proposition sur le Christ : « Et vous qui dites-vous que je suis? », et remontant le cours de l’histoire jusqu’à nous pencher sur ce que les disciples ont dit et cru de Lui, et sur ce que Jésus lui-même pensait de sa personne, en passant par ce que le Père a dévoilé au sujet de son Fils. Nous sommes partis, donc, de ce qui nous touche davantage, c’est à dire notre propre expérience du Christ ressuscité, cette expérience personnelle étant au centre de notre foi en Lui. Nous avons ensuite parcouru, avec Heidegger, les cercles qui nous mènent progressivement de notre propre milieu culturel ambiant, celui qui nous rejoint davantage et est le plus accessible à notre intelligence, vers la source même de notre foi, Jésus de Nazareth, proche par l’expérience mais très éloigné de nous par la culture et la manière de vivre. En chemin vers cette source, nous avons traversé plusieurs périodes de l’histoire qui nous ont livré une à une leur propre discours sur le Christ, et leur interprétation originale de son mystère, à partir de leur contexte culturel singulier et des données historiques qui les déterminaient. Tout au long de ce parcours, le niveau de difficulté augmentait, en ce sens que, plus le contexte culturel s’éloigne du nôtre, plus nous entrons en territoire étranger, plus le terrain de l’interprétation est glissant, et plus il est difficile de ne pas tomber dans le piège d’une interprétation faussée par nos propres schèmes culturels – parce que non suffisamment décantée subjectivement. D’autre part, nous avons pu ainsi réaliser qu’il n’existe aucun discours neutre sur le Christ et qu’il est parfaitement utopique de proclamer le contraire. Au fond, le parcours christologique suivi ensemble nous a fait vivre ce que les premiers témoins du Christ ont eux-mêmes vécus : c’est à partir de leur expérience de la résurrection de Jésus – expérience fondatrice s’il en est – qu’ils ont relu les discours et l’agir de Jésus, et finalement toute sa vie terrestre. Toute la vie de Jésus a pour eux pris un sens nouveau à partir de l’événement de sa résurrection – clé qui leur a ouvert la porte d’une interprétation éclairée sur ce personnage fascinant de l’histoire – ses motivations, son lien avec le Père, sa passion profonde pour l’humanité. Clé d’interprétation parce qu’ils ont perçu la résurrection de Jésus comme le sceau d’authentification du Père sur la vie et l’oeuvre de leur Maître et qu’ils ont pu, dès lors, laisser libre cours à leur adhésion entière à Jésus, sans plus ressentir la peur d’être trompé, ou le doute paralysant ou la crainte de faire fausse route en suivant un faux prophète tel que les en avait tant de fois mis en garde l’establishment religieux qu’ils côtoyaient : « Il faut obéir à Dieu plutôt qu’aux hommes »Ac 5, 29, ont-ils conclu à partir de l’événement de la résurrection. « Si Dieu bénit ainsi Jésus, comment ne pas le bénir également nous-mêmes? », devaient-ils se dire.
Nous de même, ce qui nous touche davantage, c’est le moment où Christ a fait irruption dans notre propre vie, la marque transformante dont Il nous a alors imprégnés. Naissent alors progressivement en nous des questions sur Lui, ce qu’Il est, ce qu’Il a été, ce qu’Il devient, et nous questionnons tour à tour les témoins de la foi qui nous entourent, ceux qui nous ont précédés, ou ceux qui l’ont côtoyé de près, à l’époque. Nous cherchons
Commentaire [r4]:
Excellent.
Note : 27,8 / 30
Commentaire [r5]:
C’est vrai; mais en même temps nous sommes plus en mesure d’apercevoir ce qui conditionnait ces discours anciens. La distance donne de la perspective. Les générations qui nous succéderont nous comprendront vraisemblablement mieux que nous ne nous comprenons nous-mêmes.
à le saisir par tous les moyens possibles, comme l’ont fait les premiers témoins avant nous. Nous commençons donc, dès le premier instant de notre quête, à faire de la christologie. L’intérêt principal de ce cours qui s’achève aura été de nous faire prendre conscience de cette vaste enquête dont chaque chrétien de l’histoire fait partie, une enquête non achevée d’ailleurs. Elle s’achèvera avec le dernier souffle du dernier enfant de Dieu vivant ici-bas et, d’ici là, tant de choses restent à saisir du mystère infini qu’est l’incarnation de Dieu même! Cette enquête n’est-elle pas, effectivement, la manifestation de ce que Paul nomme « Le corps du Christ », cette construction magnifique – digne de l’architecte de haut niveau qui l’a conçue – dont chaque élément tient en place grâce à un acte de confiance et d’amour qu’il fait à tout instant en Celui qui l’a placé(e) là où il(elle) est; acte de confiance et d’amour également en ceux et celles qui, au même titre que lui-même ou qu’elle-même, font partie de la maison que Dieu bâtit. Cet ensemble de liens vitaux qui nous unissent en Lui sont l’oeuvre ultime de Dieu, le couronnement et le but de sa Création, sa réalisation la plus chère, et le sommet de la révélation toute entière. Il ne s’agit pas là d’un oecuménisme de convenance ou d’une conciliation d’opinions divergentes sur le Christ, comprenons-le bien. Il s’agit du mystère profond de communion qu’appelait le gémissement du coeur de Jésus quand il priait : « Père saint, qu’ils soient UN comme nous le sommes »Jean 17,11. Mystère d’amour parfait où la vie divine peut circuler dans toute sa puissance, sans plus d’obstacle désormais, afin de faire d’ici bas un paradis de charité. Voilà ce qu’est EKKLESIA; possible à condition que nous oubliions, de grâce, nos institutions humaines pour y entrer avec nos coeurs entiers. Possible si nous nous investissons entièrement dans les liens quotidiens avec chaque homme et chaque femme, chaque enfant que nous côtoyons, afin qu’Il puisse nous unir ainsi jusqu’à nous souder tout à fait en Lui. Tous membres de son Corps, tous à l’écoute de la vision partielle que chacun(e) de nous a de Lui – à partir de la position qui lui est propre et du point de vue singulier qui en découle : nous aurons alors tous les éléments en main pour une christologie réussie!
Mais voilà que je glisse de mon propos initial vers l’ecclésiologie! Au fait, peut-on vraiment faire autrement? Peut-on traiter du Christ sans parler de son Corps qui est l’Ekklesia? Peut-on atteindre le Christ sans épouser amoureusement les êtres qu’Il chérit tout à fait? Peut-on approcher l’Époux sans prendre du même coup dans ses bras ses enfants tant aimés qui occupent entièrement son coeur? Mystère indissociable, à dire vrai, que le Christ et Ekklesia. Car « ce que Dieu a unit, que l’homme ne le sépare donc pas ». Mt 19,6
Nous familiariser avec les points de vue pluriels sur le Christ – comme nous l’avons fait tout au long de ce cours – nous permettra, je l’espère, d’avancer un peu plus avant dans cette communion en Lui, cessant progressivement de nous disputer sur des façons de percevoir, que nous aurons compris comme étant nécessairement – et heureusement – différentes; cherchant plutôt à nous centrer sur ce qu’Il est, Lui, dans son mystère jamais entièrement saisi, tournant nos regards vers la source même de ce que nous sommes afin de mieux devenir ce que nous sommes appelés à être. « Qui a l’épouse est l’époux »Jn 3, 29, disait Jean. Puisqu’Il est Époux, soyons celle qui tire sa joie de la Sienne : l’épousée.